



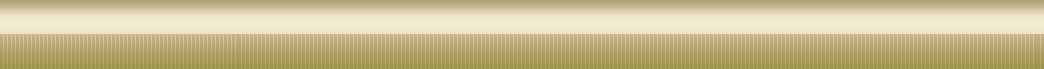

Les Maghrébins

Dans le premier numéro (janvier 1950) des Cahiers Nord-Africains, ancêtre de la revue Hommes et Migrations, on peut lire : « L’immigration nord-africaine en France est un fait désormais connu de tous. Elle crée un problème social complexe qui ne peut laisser aucun français indifférent. [...] Les Nord-Africains [...] sont : des orientaux à mentalité patriarcale ; des musulmans à réactions collectives ; des prolétaires inadaptés ». Et, un peu plus loin : « Il s’agit de musulmans. Nous nous trouvons en présence de gens qui se savent de la grande famille musulmane ; ils sont fiers d’en être, même si la pratique religieuse est totalement délaissée. Ils en ont les réactions communes, même en pays étrangers qui, pour eux, égale (sic !) pays “infidèle”. N’oublions pas que nous sommes à leurs yeux des “égarés” malgré notre supériorité technique et matérielle ». Cette citation est emblématique du regard porté pendant longtemps par de nombreux citoyens français sur les ressortissants de Tunisie, d’Algérie et du Maroc. Si le terme « nord-africain » apparaît aujourd’hui désuet, les personnes issues de ces pays et, très souvent, leurs descendants, sont désignés sous les termes « Arabes » ou « Maghrébins ». Dans l’imaginaire collectif français, il s’agirait de Moyen-Orientaux dont les sociétés prôneraient la primauté du groupe sur l’individu et l’inégalité entre les hommes et les femmes ; les Maghrébins seraient en outre très attachés – de façon plus identitaire qu’idéologique – à l’islam.
Passé colonial et histoire migratoire
Bien que partageant plusieurs caractéristiques communes, les migrations tunisienne, algérienne et marocaine ne suivent pas toujours le même schéma, et ne peuvent être amalgamées. Les relations que la France a entretenu avant la colonisation avec chacune des composantes de la mosaïque maghrébine ont été historiquement très variées. Si la Tunisie et l’Algérie appartenaient à un Empire ottoman en décadence, le Maroc n’a jamais connu la domination turque, exerçant une influence politique et commerciale sur l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. La colonisation française a contribué à accentuer cette diversité : l’Algérie a été officiellement conquise en 1830, devenant « territoire national » français ; la Tunisie et le Maroc, en revanche, ont fini par former des « protectorats », établis respectivement en 1881 et en 1912.
La nature des liens historiques et coloniaux entretenus par la France avec ces pays est essentielle pour comprendre les mouvements migratoires depuis ces territoires. La migration algérienne se dirigera quasi exclusivement vers la France (plus de 80% des émigrés), tandis que les migrations marocaine et tunisienne gagneront aussi massivement l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, l’Allemagne et la Belgique. Du milieu du XIXe siècle aux indépendances, survenues un siècle plus tard, la création d’un espace entre « deux rives » de la Méditerranée sera par ailleurs à l’origine d’une migration européenne vers l’Afrique, notamment dans la ville cosmopolite de Tunis et dans les départements algériens.
À côté de ces considérations, il ne faut pas oublier un autre aspect historique majeur. Depuis la Reconquista espagnole, le Maghreb était l’une des premières terres d’asile pour les rescapés juifs venus de la Péninsule ibérique. Avant la création de l’État d’Israël et l’instauration des gouvernements indépendants au Maghreb, à l’époque coloniale les juifs maghrébins étaient estimés à au moins 440 000 individus : 50% au Maroc, 30% en Algérie et 20% en Tunisie. Le traitement réservé par les colonisateurs aux juifs – considérés comme plus proches des Européens – sera nettement meilleur que celui réservé aux « musulmans », également appelés « indigènes ». La migration des juifs vers la France a été ainsi moins entravée que celle des musulmans.
Si dans le cadre des relations actuelles entre la France et le Maghreb il est tout à fait naturel de parler de « migrations internationales » ou, en ce qui concerne le droit des étrangers, de « code de la nationalité », autrefois, dans le contexte colonial, entre la métropole et les colonies il n’était question ni de « code de la nationalité », ni de libre circulation interne. La France avait en effet organisé la gestion des populations assujetties en se dotant d’un « code de l’indigénat » réservé aux non-Européens et en créant, au sein du ministère de l’Intérieur, un « Service des affaires indigènes nord-africaines » (disposant même d’une milice) afin de contrôler les déplacements et les activités des « indigènes », notamment dans l’Hexagone. La confession religieuse réelle ou supposée faisait alors office de critère de distinction entre les différents statuts de citoyenneté au sein de cette région de l’Empire français, comme l’affirmait en 1903 la Cour d’appel d’Alger, en avançant que le terme musulman : « n’a pas un sens purement confessionnel [...], il désigne au contraire l’ensemble des individus d’origine musulmane n’ayant point été admis au droit de cité ».
La migration maghrébine avant les indépendances
Les populations de l’Afrique du Nord-Ouest étaient relativement mobiles au sein du monde musulman et ottoman. L’autorité française, tout en affirmant une libre circulation de principe à l’intérieur de ses domaines, s’opposa de fait à l’instauration de flux migratoires importants entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée. Pour venir dans l’Hexagone, outre un revenu conséquent, les indigènes devaient être en possession d’une « autorisation de voyage » : ceux qui prenaient le bateau en seconde classe faisaient souvent l’objet d’un rapatriement.
Avant la Première Guerre mondiale, les Maghrébins présents en France étaient relativement peu nombreux. Recensés comme étant quelques dizaines de milliers, ils venaient notamment de la Kabylie et de la région marocaine d’Agadir. Les Algériens étaient donc surtout des Kabyles, des Berbères historiquement peu enclins à se laisser soumettre politiquement et culturellement.
L’évolution des flux migratoires de la première moitié du XXe siècle suit grosso modo les grandes lignes que nous avons tracées dans la fiche [#623] : la métropole recrute massivement des soldats et des ouvriers dans ses colonies pour répondre aux besoins économiques et militaires durant les deux guerres mondiales, mais à l’heure de l’armistice elle les rapatrie aussitôt.
En 1918, la France compte plus de 60 000 Algériens. Beaucoup restent clandestinement sur le territoire et servent de point d’appui pour d’autres arrivées, générées par la crise économique qui fait suite au conflit. Ils sont souvent « triés » au port de Marseille et « répartis » dans les villes industrielles françaises. Ils inaugurent ainsi, jusqu’en 1940, une « noria » migratoire qui les fait demeurer dans l’Hexagone entre huit et dix-huit mois avant de partir et de laisser la place à des proches. On estime que ce système de circulation migratoire a concerné un demi million de personnes. Ces pionniers sont perçus par les autochtones comme des « déracinés » (ce sont surtout des hommes) sortant directement du Moyen-Âge, tandis que leurs familles restées au pays se soucient de leur âme dans un milieu dépravé car situé en dehors du monde musulman.
Les Marocains, en revanche, beaucoup moins nombreux durant la même période (3 000 en 1919 et 21 000 en 1939), sont employés dans les mines, dans l’industrie métallurgique et dans la construction. Le patronat français les préfère de loin aux Algériens, officiellement en raison de leur meilleures performances, en réalité parce que les seconds sont réputés comme étant plus revendicatifs. En effet, un certain nombre d’Algériens kabyles, plus à l’aise avec la législation française, et plus intéressés par les questions politiques, grâce à leurs contacts avec le communisme hexagonal, développent durant l’entre-deux-guerres un nationalisme croissant, incarné en particulier par le parti de l’Étoile nord-africaine (1926-1937) dirigé par Messali Hadj.
En ce qui concerne les Tunisiens, à l’issue de la Grande Guerre, à laquelle environ 20 000 avaient contribué comme ouvriers et tirailleurs, ils ne sont plus que quelques individus (700 à 800).
Parmi les Algériens, certains élaborent un projet migratoire plus « individuel », souhaitant couper les ponts avec l’emprise du clan d’origine et de l’assemblée des « anciens » du village (djem’a). Les Kabyles les appellent alors « amjahin », « ceux qui se sont perdus ». Souvent ces migrants épousent des Françaises.
Durant l’entre-deux-guerres plusieurs institutions au bénéfice des Nord-Africains voient le jour : la Mosquée de Paris (1926), l’Hôpital franco-musulman de Paris (1935, aujourd’hui dénommé « Avicenne ») et le cimetière franco-musulman de Bobigny (1935). Officiellement, ces réalisations entendent célébrer le sacrifice accompli par les Maghrébins durant la Première Guerre mondiale, mais les motifs à l’origine de leur construction vont parfois dans le sens d’un contrôle des populations immigrées.
À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, le nationaliste algérien Messali Hadj fonde le Parti du Peuple Algérien (PPA), qui sera remplacé en 1947 par le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTDL). Quelques années plus tard, en 1954, plusieurs partis algériens prônent l’indépendance de leur pays, mais seul le Front national de libération (FLN) se dotera d’une branche armée qui passera à l’action, entraînant la riposte française dans une spirale qui conduira à la « guerre d’Algérie » (1er novembre 1954 - 9 septembre 1962).
Le conflit franco-algérien a des répercussions importantes sur la diaspora maghrébine et sur les flux migratoires depuis l’Afrique du Nord vers la France. Au début des hostilités, beaucoup d’Algériens rentrent au pays, tandis qu’une petite partie des immigrés présents dans l’Hexagone s’acquitte de la cotisation demandée par le FNL (quelques milliers d’anciens francs). Dans le même temps, les populations marocaines du « Rif central » (Côte est de la Méditerranée autour de la ville d’Al-Hoceima), qui traditionnellement migraient en Algérie lors des saisons des récoltes, subissent une forte crise économique et empruntent alors le chemin de l’exil qui les conduit vers la métropole, avec notamment comme points de chute Clichy et Gennevilliers en région parisienne.
À l’issue de la guerre, un million d’Européens quittent l’Afrique, un mouvement qui occulte médiatiquement un autre flux, certes moins nombreux mais massif, d’Algériens vers la France (et, parmi eux, plus de 40 000 harkis et proches de harkis : cf. la fiche [#624]). En 1965 d’autres arrivent en tant que réfugiés fuyant le régime instauré par Houari Boumédiène après son coup d’État.
Les migrants maghrébins des indépendances à nos jours
Les indépendances de la Tunisie (1956), du Maroc (1958) et de l’Algérie (1962) marquent un tournant qui entraîne une redéfinition des relations de ces pays avec la France, notamment dans le domaine migratoire. Au début, l’ancienne métropole, soucieuse de protéger ses ressortissants qui résident encore sur le territoire des États nouvellement indépendants, s’accorde avec leurs gouvernements pour assurer une liberté de circulation réciproque. Ces dispositions ne durent que peu d’années, rapidement remplacées par des obligations de visa. Au lendemain des indépendances, tout le Maghreb connaît des difficultés économiques et sécuritaires : le chômage y est élevé, tandis que les manifestations contre les autorités au pouvoir sont réprimées violemment. Si nombre d’Algériens arrivent dans l’Hexagone clandestinement et se présentent directement aux portes des usines, l’Office national d’immigration (ONI) et le patronat français prospectent surtout dans le Rif marocain et en Tunisie : les travailleurs se rendent en France en situation irrégulière, pour être ensuite régularisés par les entreprises via l’ONI.
Entre 1963 (Maroc et Tunisie) et 1968 (Algérie) la France signe avec les pays du Maghreb des accords de main-d’œuvre. Le nombre de travailleurs marocains et tunisiens s’accroît alors considérablement : à la fin des années 1960, les premiers dépasseront les 300 000, tandis que les seconds seront plus de 60 000. Les métiers exercés par les nouveaux arrivants iront de l’« ouvrier spécialisé » au mineur, du travailleur des charbonnages (notamment les Marocains) au maçon (en particulier les Tunisiens). En Tunisie, les candidats à l’hijra (exil) doivent d’abord suivre une formation professionnelle dans le bâtiment, pour être ensuite envoyés en France aux frais de l’État tunisien.
La plupart de ces nouveaux « travailleurs immigrés » vivent dans des conditions difficiles à la périphérie des aires industrielles : soit dans des bidonvilles, soit dans des « cités de transit » construites à la hâte après la crise du logement survenue durant le rude hiver de 1954, qui avait vu mourir de nombreux sans-abri. Si les Algériens sont très présents dans les rangs des syndicats, les autres Maghrébins semblent, de ce point de vue, plus « passifs » aux yeux du patronat.
La suspension de l’immigration de travail, décrétée par le gouvernement français en juillet 1974, marque paradoxalement le début d’un accroissement important de la population maghrébine dans l’Hexagone (+90% de Marocains entre 1974 et 1986 ; +80% de Tunisiens durant la même période), sauf en ce qui concerne les Algériens (+14% en dix ans). Les entrées dans le cadre du regroupement familial s’intensifient alors que le chômage augmente et que la ségrégation urbaine devient de plus en plus évidente.
L’histoire des migrations maghrébines durant les années 1980-2010 suit les grandes lignes exposées dans les fiches du Migral relatives à l’immigration en France durant cette époque, qui voit l’émergence des questions sociales et culturelles posées par des populations qui demandent plus d’égalité. Au malaise ressenti par les habitants de nombreux quartiers des « banlieues sensibles » qui entourent les grandes agglomérations françaises (discrimination à l’emploi, ascension sociale difficile, radicalisme religieux, etc.), s’ajoutent parfois des problématiques identitaires, certaines personnes étant davantage perçues comme « musulmanes » et non comme françaises, algériennes, marocaines ou tunisiennes.
suit les grandes lignes exposées dans les fiches du Migral relatives à l’immigration en France durant cette époque, qui voit l’émergence des questions sociales et culturelles posées par des populations qui demandent plus d’égalité. Au malaise ressenti par les habitants de nombreux quartiers des « banlieues sensibles » qui entourent les grandes agglomérations françaises (discrimination à l’emploi, ascension sociale difficile, radicalisme religieux, etc.), s’ajoutent parfois des problématiques identitaires, certaines personnes étant davantage perçues comme « musulmanes » et non comme françaises, algériennes, marocaines ou tunisiennes.
En 2018, d’après l’INSEE, le nombre d’immigrés maghrébins en France s’élevait à plus de 1,77 million de personnes, chiffre qui ne tient pas compte des descendants et des naturalisés. Il s’agit de la présence immigrée la plus importante dans l’Hexagone. Si les flux migratoires depuis le Maghreb sont toujours d’actualité (58 000 entrées régulières enregistrées en 2017), plus de 230 000 immigrés ont atteint l’âge de la retraite (dont 55% d’origine algérienne) et une grande partie de ces chibanis n’ont pas de perspectives de retour, continuant à vivre d’une maigre pension, dont le montant varie entre 300 et 700 euros par mois.
n’ont pas de perspectives de retour, continuant à vivre d’une maigre pension, dont le montant varie entre 300 et 700 euros par mois.
Les immigrés maghrébins perçus comme la communauté des « Musulmans »
En France, depuis quelques décennies, pour une bonne partie de l’opinion publique le référent ou attribut « musulman » semble avoir pris le dessus sur toutes les autres considérations qui pourraient définir les populations immigrées ou descendantes d’immigrés en provenance notamment du Maghreb. Ce processus d’« islamisation » découle de deux phénomènes : l’« assignation communautaire » de la part des non-musulmans qui désignent des groupes très hétérogènes comme étant une « communauté (ethnique) musulmane » homogène ; et l’« auto-assignation » assumée par de nombreux individus qui se revendiquent musulmans soit par fierté, soit par opposition à ceux qui méprisent l’islam.
Les statistiques sur les musulmans dans l’Hexagone font souvent l’objet de polémiques. C’est surtout dans les années 1990 qu’émerge la question de la comptabilisation des immigrés selon leur identité religieuse. Les enquêtes de l’Institut national des études démographiques (INED) et de l’INSEE dénombrent à cette époque 3,5 millions de musulmans, dont le nombre en 2014 serait passé à 4,5 millions. Ce chiffre, compris aujourd’hui dans une fourchette allant de 4,5 millions à 4,8 millions de personnes, contredit les déclarations de certains partis politiques ou de certains essayistes qui évoquent 7 ou 8 millions de musulmans en France. Selon les deux instituts cités, entre 2 et 2,5 millions d’individus se déclarent musulmans, auxquels il faut ajouter entre 70 000 et 100 000 convertis à l’islam. Le taux de conversions de la foi musulmane au catholicisme s’élèverait en revanche aux alentours de 150-200 personnes par an. Parmi les individus catégorisés comme musulmans, un tiers se déclarerait croyant et pratiquant, un tiers seulement croyant et un tiers « d’origine musulmane ».
La perception de la « question musulmane » par la société française non musulmane
En France, si on se base sur l’analyse faite par les chercheurs sur la représentation médiatique de la « question musulmane », au cours de l’ère contemporaine, trois étapes au moins se dessinent.
La première va de la Grande Guerre jusqu’à la fin des années 1970 et coïncide avec les vagues migratoires depuis le Maghreb. Durant cette phase, le travailleur immigré est vu sous un jour paternaliste, car il est souvent originaire du milieu rural, célibataire et analphabète, sa religion étant perçue comme une simple « tradition » et un facteur de « paix sociale » : pour le patronat, mieux vaut avoir des gens qui prient plutôt que des gens qui militent dans les syndicats.
La seconde étape, sorte de tournant phobique, survient en 1979, année de la révolution en Iran. Cette dernière va avoir des résonances internationales et nationales et la peur de la contamination du soulèvement iranien chiite (alors qu’en France l’islam est surtout sunnite) va produire une radicalisation des représentations autour de la présence immigrée, désormais présentée comme musulmane et potentiellement intégriste. Les revendications sociales portées par les ouvriers maghrébins dans les années 1980 sont parfois interprétées par les ministres des gouvernements en charge (Pierre Mauroy, Jean Auroux, etc.) comme des revendications islamistes.
La troisième étape débute en 1989, au niveau international avec l’affaire Salman Rushdie, et au niveau national avec l’affaire du voile à Creil. En s’appuyant sur des épisodes ou des faits interprétés comme des signes de la montée de l’intégrisme religieux, les discours politiques sur l’islam contribuent peu à peu à accroître la peur à l’égard des musulmans, qui, eux, ne s’expriment pas. Durant les années 1990, la guerre civile en Algérie (survenue après l’annulation des élections législatives de 1991 qui avaient vu la victoire du Front islamique du Salut – FIS – au premier tour), les actes terroristes perpétrés par le Groupe islamique armé (le GIA de Khaled Kelkal, 1995) et l’assassinat des moines de Tibhrine (1996) vont entretenir l’idée qu’il existe une menace islamique et que l’islam est de plus en plus visible.
Les attentats du 11 septembre 2001 aux USA ne viennent qu’aggraver une tendance affirmée depuis la décennie précédente. La menace islamique est alors perçue comme mondiale, nationale (= elle concerne aussi les musulmans français et pas seulement les étrangers) et féminisée (port du voile). Parallèlement à l’instrumentalisation de la peur antimusulmane, au niveau local le monde politique montre paradoxalement des dynamiques d’insertion de l’islam : bon accueil des associations musulmanes dans les mairies, appui municipal à la construction de mosquées, etc.). Par ailleurs, les amalgames entre islam et banlieues défavorisées deviennent de plus en plus communs.
au niveau local le monde politique montre paradoxalement des dynamiques d’insertion de l’islam : bon accueil des associations musulmanes dans les mairies, appui municipal à la construction de mosquées, etc.). Par ailleurs, les amalgames entre islam et banlieues défavorisées deviennent de plus en plus communs.
Un lien entre le fait migratoire et le fait musulman ?
En partie pour s’opposer aux caricatures, aux préjugés et aux idées reçues des médias, les chercheurs (sociologues, politologues, etc.) ont tendance à nier la persistance de l’aspect ethnique auprès du soi-disant « islam français ». Mais en observant les réalités musulmanes à la loupe, les origines ethniques et culturelles de l’islam immigré caractérisent toujours la vie de l’islam français. Les mosquées, par exemple, demeurent fortement structurées par les nationalités des pays d’origine : mosquées algériennes, mosquées marocaines, mosquées comoriennes, etc. Ce phénomène, qui se retrouve dans tous les groupes immigrés quelle que soit leur religion, est particulièrement accentué chez les musulmans maghrébins, dont les mosquées sont (notamment à Marseille) parfois « contrôlées » par les consulats des pays d’origine, et ce, bien que les enfants d’immigrés ne se réclament plus de la nationalité de leurs parents.








