



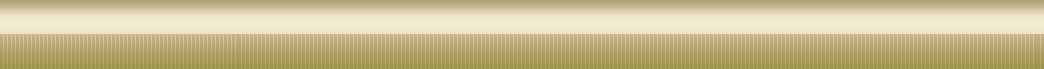

La protection subsidiaire
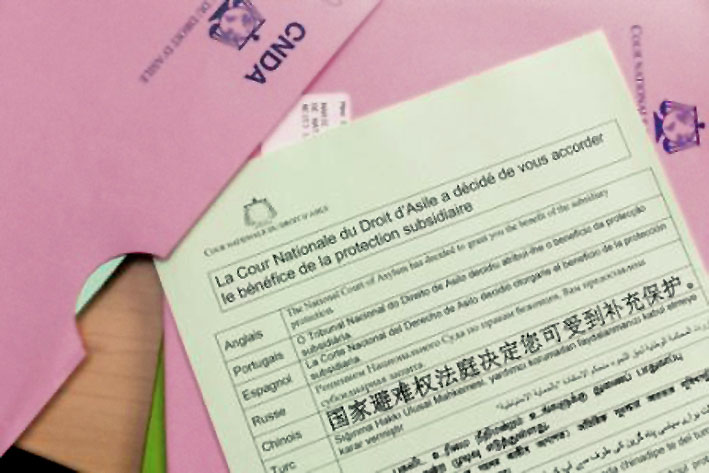
Des divergences importantes ont existé en Europe, notamment jusqu’au milieu des années 2000, et dans le monde en matière d’interprétation de la définition du réfugié.
Si les principaux points de divergence ont été dépassés par l’adoption de directives européennes fixant des critères communs, les différences d’appréciation des cas individuels et des situations existantes dans les pays d’origine persistent, lesquelles se reflètent dans les taux de reconnaissance de la qualité de réfugié à des ressortissants d’un même pays d’origine, variables d’un pays d’accueil à l’autre. En outre, l’interprétation donnée par chaque État à la notion de « groupe social » au sens de la définition du réfugié donnée par la convention de Genève de 1951 étant variable, elle peut expliquer des différences d’appréciation des cas individuels fort éloignées.
Jusqu’à l’adoption des directives mentionnées, l’une des principales divergences portait sur le fait de savoir si la convention de Genève de 1951 s’appliquait seulement aux personnes menacées ou victimes de persécutions exercées par l’État auquel elles ressortissaient ou commises avec la complicité ou la tolérance de ce dernier, ou si elle s’appliquait également aux personnes menacées que l’État d’origine ne pouvait plus protéger, soit parce qu’il était impuissant à le faire, soit parce qu’il avait cessé d’exister. Il s’agit là de la question de l’“agent de persécution” au sens de la convention de Genève.
La France, par exemple, jusqu’à la “loi Sarkozy” de 2003, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux personnes qui n’étaient pas menacées par leur État d’origine ou par des groupes privés agissant pour l’État ou avec la complicité implicite ou explicite de ce dernier.
Toutefois, pour faire face à des réalités pressantes mais toujours présentées comme “exceptionnelles”, les autorités ont fait appel à des procédures de contournement à la fois des principes régissant la situation des réfugiés et les positions officielles de l’État français.
Pendant pratiquement toute la durée de la guerre civile au Liban , la France refusait officiellement, selon une doctrine validée par le Conseil d’État, d’appliquer la convention de Genève de 1951 aux Libanais, alléguant que ces derniers n’étaient pas victimes des agissements de l’État libanais, mais de ceux de groupes privés dans le cadre d’un conflit interne. À une ou deux exceptions près - lorsque le réfugié a pu apporter la preuve que l’État libanais le menaçait - jusqu’en 1975 aucun Libanais n’a obtenu le statut de réfugié en France. Néanmoins, compte tenu des liens historiques entre les deux pays et de la présence d’une importante communauté libanaise en France, les autorités françaises ont accordé un asile territorial de facto a de nombreux Libanais, au moyen de la délivrance de visas d’une durée variable selon les périodes - mais toujours supérieure à trois mois -, accompagnée de l’inclusion des bénéficiaires de ces visas sur la liste, modifiable par simple arrêté du ministre de l’Intérieur, des pays dont les ressortissants ne pouvaient pas se voir refuser la délivrance d’un titre de séjour en raison de la situation du marché du travail.
, la France refusait officiellement, selon une doctrine validée par le Conseil d’État, d’appliquer la convention de Genève de 1951 aux Libanais, alléguant que ces derniers n’étaient pas victimes des agissements de l’État libanais, mais de ceux de groupes privés dans le cadre d’un conflit interne. À une ou deux exceptions près - lorsque le réfugié a pu apporter la preuve que l’État libanais le menaçait - jusqu’en 1975 aucun Libanais n’a obtenu le statut de réfugié en France. Néanmoins, compte tenu des liens historiques entre les deux pays et de la présence d’une importante communauté libanaise en France, les autorités françaises ont accordé un asile territorial de facto a de nombreux Libanais, au moyen de la délivrance de visas d’une durée variable selon les périodes - mais toujours supérieure à trois mois -, accompagnée de l’inclusion des bénéficiaires de ces visas sur la liste, modifiable par simple arrêté du ministre de l’Intérieur, des pays dont les ressortissants ne pouvaient pas se voir refuser la délivrance d’un titre de séjour en raison de la situation du marché du travail.
Ce même subterfuge a été utilisé au début des années 1980 pour autoriser le séjour, assorti du droit de travailler, à des Polonais qui, à la suite de l’imposition de l’état d’urgence dans leur pays venaient en France, et ce sans qu’ils aient besoin de demander la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Toutefois, au début des années 1990, trois faits vont commencer à changer la donne :
- premièrement, l’arrivée d’un faible nombre de Somaliens fuyant la situation créée dans leur pays par l’effondrement des structures étatiques ;
- l’arrivée d’un nombre de plus en plus important de personnes fuyant les guerres civiles dans la Yougoslavie en pleine désagrégation,
- l’arrivée de nombreux Algériens victimes des violences politiques commises dans le cadre d’une guerre civile où les exactions se multipliaient tant de la part des groupes islamistes armés que de la part des forces militaires et de police.
Coincée entre la rigidité de sa doctrine officielle relative à l’“agent de persécution”, l’arrivée sur son territoire des victimes de la violence et les mouvements de solidarité avec ses dernières, l’État français a fait appel à de nouveaux “expédients” juridiques.
Pour reconnaître la qualité de réfugié à certaines personnes persécutées sans officiellement déroger à sa doctrine de l’“agent de persécution”, la Commission des recours des réfugiés (devenue la Cour nationale du droit d’asile), avec l’aval du Conseil d’État, a introduit dans la jurisprudence la catégorie des “autorités de fait”, qui contrôlaient certaines parties du territoire de l’État d’origine du réfugié et y exerçaient une autorité assimilable à l’autorité étatique. Ces décisions étaient cependant relativement peu nombreuses, l’État craignant toujours de se voir “débordé” par ce qu’il se plaît à nommer l’“appel d’air”, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance d’une carte de résident valable dix ans, de même que le respect des garanties offertes par la convention de Genève de 1951.
Comme la France érige le droit d’asile en principe constitutionnelQK, comme elle est signataire de conventions régionales ou internationales interdisant le renvoi d’une personne vers un pays où sa vie, sa sécurité ou son intégrité est menacée, comme la convention de Genève et le protocole de New York l’obligent à respecter le principe du non-refoulement, il lui est impossible de refuser, sans se discréditer, toute forme d’asile aux personnes qui ne peuvent être renvoyées mais auxquelles elle refuse par ailleurs la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Durant les années 1990, l’État va alors décider d’inscrire l’asile territorial dans le droit positif, en plus des simples déclarations de principes des années 1950 et 1960. Il s’agit néanmoins de légiférer sur les conditions dans lesquelles l’État a le droit d’accorder le droit de séjour au titre de l’asile territorial, mais en aucun cas de poser les bases d’un droit à l’asile territorial dont pourraient se prévaloir des victimes de persécutions auxquelles la France refusait de reconnaître la qualité de réfugié.
C’est pourquoi une forme d’asile territorial est-elle alors accordée, au compte-gouttes, à certains groupes de personnes, selon des modalités à chaque fois distinctes. La plupart du temps, les personnes se voient délivrer des titres de séjour très précaires (autorisations provisoires de séjour valables trois ou six mois, renouvelables), comprenant ou non le droit au travail ; parfois elles obtenaient un titre de séjour d’une durée d’un an. Tantôt les circulaires ministérielles fixant les modalités de l’asile étaient connues rapidement, même si elles n’étaient pas officiellement publiéesQK, tantôt les règles régissant l’asile territorial accordé parcimonieusement à certaines catégories de personnes étaient gardées confidentielles par l’administrationQK.
Ce “subterfuge” juridique va tomber en désuétude à partir de l’officialisation par l’Union européenne de ce que l’on appelle la “protection subsidiaire”. Il s’agit d’une forme de protection accordée à des personnes que les organismes compétents considèrent comme n’étant pas des réfugiés selon la convention de Genève de 1951 mais qui « ont des motifs sérieux et avérés de croire qu'elles courraient dans leur pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
« la peine de mort ou une exécution;
« la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants;
« pour des civils, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.»QK
Les personnes placées sous le régime de la protection subsidiaire ont en principe droit à une carte de séjour temporaire d'une durée d’un an renouvelable et portant la mention « vie privée et familiale », ce qui leur donne le droit de travailler. Compte tenu de la durée de leur titre de séjour, elles sont maintenues dans une situation précaire et instable et ne bénéficient pas de la plupart des droits reconnus aux réfugiés, pas même du droit au regroupement familial.
Enfin, il convient de souligner que parfois, la France refuse d’octroyer une quelconque forme de protection officielle. Les personnes déboutées de leur demande mais qui ne peuvent pas être renvoyées demeurent ainsi dans un état de non-droitQK, vivant une sorte d’ « asile au noir».








