



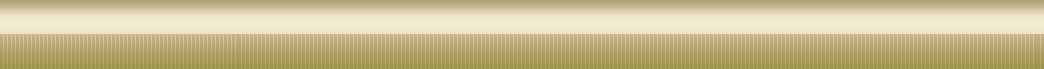

France : de l’arrêt de l’immigration de travail aux premières « lois Pasqua » (1974-1988)

L’arrêt de l’immigration de travail et la politique du retour
Peu avant le « choc pétrolier » de 1973, l’opinion publique française s’inquiète de la dégradation progressive des grands ensembles dans les banlieues, imputée, selon elle, à la présence immigrée. Beaucoup d’autochtones agitent le spectre de l’« invasion », en raison du nombre plus élevé d’étrangers dans le parc social ; ces derniers représentent 8,9 % de la population en 1968 et 11,7 % en 1975. Évoquant la présence immigrée, le Conseil économique et social parle même d’un « seuil de tolérance », qu’il fixe « scientifiquement » à 20 % pour les Européens et à 15 % pour les « autres ». L’illusion de pouvoir intégrer aisément les travailleurs venus d’ailleurs diminue progressivement et, dès 1973, les agressions à leur encontre se multiplient.
Au milieu de ces tensions sociales, en 1974, Valéry Giscard d’Estaing, nouveau président de la République, confie à André Postel-Vinay -- un inspecteur des Finances passionné par les questions du tiers monde -- le portefeuille de secrétaire d’État à l’immigration. Postel-Vinay estime que la France ne peut plus accepter de migrants, mais qu’elle a une dette envers eux : à la fermeture des frontières devrait correspondre une amélioration des conditions sociales des immigrés déjà installés sur le sol français. Le 3 juillet 1974, le Conseil des ministres, présidé par le Premier ministre, Jacques Chirac, accepte le plan de Postel-Vinay et suspend l’immigration . Les frontières sont officiellement fermées à la main-d’œuvre étrangère ; alors que dans le même temps les aides sociales promises aux immigrés se font attendre.
. Les frontières sont officiellement fermées à la main-d’œuvre étrangère ; alors que dans le même temps les aides sociales promises aux immigrés se font attendre.
Au lendemain de l’arrêt officiel de l’immigration de travail, la France compte 3,4 millions d’étrangers, majoritairement des Portugais, des Algériens, des Italiens, des Espagnols, des Marocains, des Tunisiens, des Turcs et des Yougoslaves. En 1981, ils seront 4,2 millions, suite aux regroupements familiaux et aux régularisations. De plus en plus les enfants d’immigrés font leur apparition dans les classes des écoles de certaines communes, obligeant parfois les établissements scolaires concernés à mettre en œuvre des programmes spécifiques, ciblant en particulier les élèves d’origine algérienne et portugaise.
Dans le même temps, suite au coup d’État au Chili en septembre 1973, la France accueille quelque 15 000 réfugiés en provenance de ce pays, que l’opinion publique, influencée par les mythes révolutionnaires de mai 1968, voit sous un jour plutôt favorable. Un peu plus tard, en 1975, après les conflits meurtriers survenus dans l’ancienne Indochine, une direction du ministère des Affaires étrangères met en place un dispositif d’accueil particulier à destination des réfugiés vietnamiens, cambodgiens et laotiens, qui prendra en charge jusqu’en 1980 un quota annuel d’environ un millier d’exilés .
.
Entre 1975 et 1977, le responsable de la Direction de la population et des migrations (DPM), Paul Dijoud, tente d’organiser une politique d’immigration basée sur l’insertion sociale des travailleurs immigrés et sur des accords avec leurs pays d’origine afin de maîtriser les flux migratoires, qui se poursuivent malgré la fermeture des frontières. Son initiative sonnant comme un constat d’échec, en 1977 il est remplacé par Lionel Stoléru, connu pour sa politique du « retour » et des expulsions, justifiée devant l’opinion publique par la montée inquiétante du chômage. L’année de sa nomination, Stoléru met en place un dispositif d’aide au retour, constitué par le versement d’une allocation de 10 000 francs (« le million Stoléru ») aux ressortissants extracommunautaires en situation régulière sur le territoire et volontaires pour retourner définitivement avec leurs familles dans leurs pays d’origine. L’aide au retour, censée rééquilibrer le marché du travail, sera supprimée en 1981 en raison du constat de sa faible efficacité, après avoir concerné moins de 100 000 personnes, dont 65% de ressortissants de la péninsule ibérique et à peine 3,7% d’Algériens.
La promulgation en 1980 de la « loi Bonnet » (du nom du ministre de l’Intérieur) est emblématique de cette époque puisqu’elle va, pour la première fois, toucher à l’ordonnance de 1945, en donnant à l’administration la possibilité concrète de renvoyer les étrangers en situation irrégulière.
La période de l’optimisme
Les années qui vont de l’élection de François Mitterrand (1981) à la première cohabitation (1986) sont, malgré l’acuité des problématiques sociales, caractérisées par une sorte d’optimisme quant à la possibilité d’une insertion sociale des immigrés et de leurs descendants grâce à des lois plus souples et à des « dispositifs » considérés comme appropriés. Les raisons de cet espoir sont multiples : a) la législation accorde enfin la possibilité aux étrangers de créer des associations ; b) en 1981, 130 000 clan bénéficient d’une régularisation ; c) à partir de 1982, est mis en place un programme gouvernemental de « développement social des quartiers », ayant pour but d’améliorer les conditions de vie dans les habitats défavorisés, et qui conduit, entre autres, à la création de « zones d’éducation prioritaire » (ZEP) et à l’instauration, au début des années 1990, d’une véritable politique de la ville ; d) en 1983, à l’issue de la première « marche des Beurs »QK -- organisée entre Marseille et Paris par plusieurs collectifs suite aux bavures policières dont ont été victimes des jeunes d’origine maghrébine habitant les banlieues lyonnaise et marseillaise -- qui rassemble plus de 100 000 manifestants, le Président de la République fait plusieurs promesses à la délégation des marcheurs qu’il reçoit à l’Élysée ; e) le gouvernement décide la création d’un titre unique de séjour et de travail, valable dix ans.
La fin des illusions
L’enthousiasme suscité par ces mesures est de courte durée. En 1983 déjà, les sondages sur la politique gouvernementale d’immigration sont assez négatifs. Dans les textes législatifs et dans les budgets publics, le contrôle des frontières prime de fait l’insertion des immigrés. Les demandes d’admission au séjour font dans leur grande majorité l’objet d’un refus ; les déboutés qui choisissent de rester en France se retrouvent alors dans l’illégalité.
En 1986, la droite reprend le pouvoir, et le nouveau ministre de l’Intérieur, Charles Pasqua, affirme vouloir combattre l’« insécurité », thématique qui avait permis au Front national d’accéder au Parlement . Après l’expulsion symbolique par vol charter de 101 Maliens clandestins, il promulgue une loi donnant tout pouvoir aux préfets de prononcer la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière.
. Après l’expulsion symbolique par vol charter de 101 Maliens clandestins, il promulgue une loi donnant tout pouvoir aux préfets de prononcer la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière.
Enfin, en 1988, symboliquement, l’Office national de l’immigration (ONI) change de nom et devient l’Office des migrations internationales (OMI) ; le mot « immigration » est désormais tabou.








